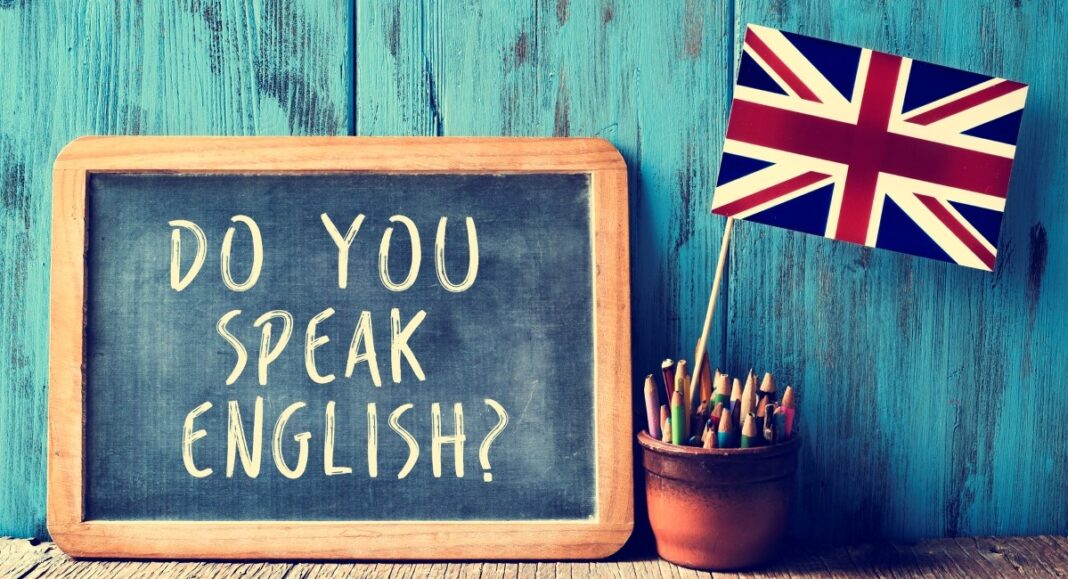« Tu pars six mois dans un pays, tu reviens bilingue ! ». On l’a tous déjà entendu. Et on aimerait y croire. Mais entre immersion et illusion, la frontière est parfois mince. Car vivre à l’étranger ne garantit en rien une maîtrise fluide d’une langue. Et encore moins en quelques mois.
« Le problème avec les communautés d’expatriés, c’est qu’on n’est jamais vraiment seul », observe Elnett Lucas, linguiste et professeure d’anglais, « on peut passer plusieurs mois à l’étranger sans avoir de véritables échanges dans la langue locale.» Dans bien des cas, l’environnement social permet de fonctionner avec des dialogues très courts. Le cerveau, qui cherche naturellement à économiser de l’énergie, s’adapte à ce niveau minimal sans chercher à progresser davantage. On fait ses courses, on commande un café, on échange quelques mots avec des collègues… mais sans entrer dans des discussions qui sollicitent réellement la mémoire, la compréhension ou l’expression.
L’illusion de l’immersion magique
Cette immersion passive est d’autant plus fréquente que beaucoup de jeunes expatriés restent entre compatriotes. Or, comme le soulignent de nombreuses études en psycholinguistique, l’exposition seule à une langue ne suffit pas à en favoriser l’acquisition. L’apprentissage s’effectue lorsque l’on est activement engagé dans des situations de communication.
« Une langue prend plusieurs années à s’apprendre, et ce que l’on apprend dépend beaucoup du contexte culturel auquel on est exposé », rappelle Elnett Lucas. L’environnement social modèle le vocabulaire et les usages : un étudiant ne parlera pas comme un serveur, ni comme un jeune parent. L’illusion de “l’immersion magique” repose souvent sur une surestimation de la simple présence dans un pays étranger.
Ce que l’oreille n’entend plus
Un autre facteur rend l’apprentissage plus lent qu’on ne le pense : la perception des sons. « La phonétique est un mécanisme biologique. Jusqu’à l’adolescence, notre cerveau est très sensible aux sons d’une langue. Après cette période, il devient plus difficile de percevoir les sons qui n’existent pas dans notre langue maternelle », explique Elnett Lucas.
Ce phénomène, bien documenté en linguistique, est lié à la “période critique” du développement phonologique. Il explique pourquoi un adulte francophone peut avoir du mal à distinguer ou reproduire des sons comme le th anglais, ou certaines voyelles longues.
Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas progresser, mais cela demande une attention spécifique. Pour développer son oreille, il faut écouter de manière active, observer les natifs, reproduire les sons à haute voix… Ce que beaucoup ne font pas naturellement, faute de temps ou d’enjeu. Là encore, la simple exposition ne suffit pas.
Intention et engagement, le moteur de l’apprentissage
« L’apprentissage d’une langue passe par la volonté de transmettre un message », insiste Elnett Lucas. Lorsque l’on est motivé pour comprendre et se faire comprendre, le cerveau s’active, la mémoire travaille, les automatismes se mettent en place.
Mais cette dynamique ne fonctionne que si l’on sort de sa zone de confort linguistique. Travailler ou pratiquer une activité dans la langue cible, s’éloigner (au moins un peu) des cercles francophones, vivre des émotions dans la langue étrangère : voilà ce qui crée les conditions d’un apprentissage durable. « Il faut un objectif précis : des liens sociaux, une passion, un engagement. Cela pousse à pratiquer, sans que ce soit perçu comme un effort », explique la linguiste sud-africaine.
Enfin, reste la question du mot “bilingue”. Il évoque souvent une maîtrise parfaite, mais les chercheurs en didactique des langues invitent à une définition plus souple. Être bilingue, c’est pouvoir fonctionner efficacement dans deux langues — pas forcément à niveau égal, ni dans tous les contextes. « La langue est un code qui varie selon les milieux. On peut être compétent dans un contexte et complètement perdu dans un autre », résume Elnett Lucas.
En somme, vivre à l’étranger est un levier précieux, mais ce n’est pas une garantie. Le bilinguisme ne s’attrape pas, il se construit. Et ce sont l’engagement actif, la curiosité, et la qualité des interactions qui font, sur le long terme, toute la différence.